Vous l’avez peut-être constaté, depuis plusieurs années, l’ostéopathie est régulièrement critiquée dans l’espace médiatique. Articles à charge, alertes sur les dérives, rappels aux risques supposés : la tonalité est souvent la même.
Je me sens rarement visé personnellement par les accusations mais j’avoue souffrir de cette stigmatisation professionnelle.
Non. Je ne manipule pas les cervicales des nourrissons comme il a été montré dans un reportage sur France 2 au 20h il y a quelques mois… Je ne promets pas de solutions miracle à des personnes confrontées aux échecs de la médecine allopathique comme c’est souvent dénoncé… Je ne pratique pas de techniques internes.
En réalité, j’en suis convaincu, la très grande majorité des ostéopathes sont comme moi. Pourtant on pourrait croire avec la critique constante de l’ostéopathie dans les médias que les dérives décrites correspondraient à une réalité répandue.
Certains finissent par s’interroger : pourquoi une telle récurrence ? D’où vient cette tension ? Et surtout, pourquoi ne semble-t-elle pas s’appliquer avec la même intensité à d’autres domaines de la santé, pourtant eux aussi traversés par des limites, des abus ou des zones d’ombre ?
Cette question mérite qu’on prenne le temps d’y répondre.
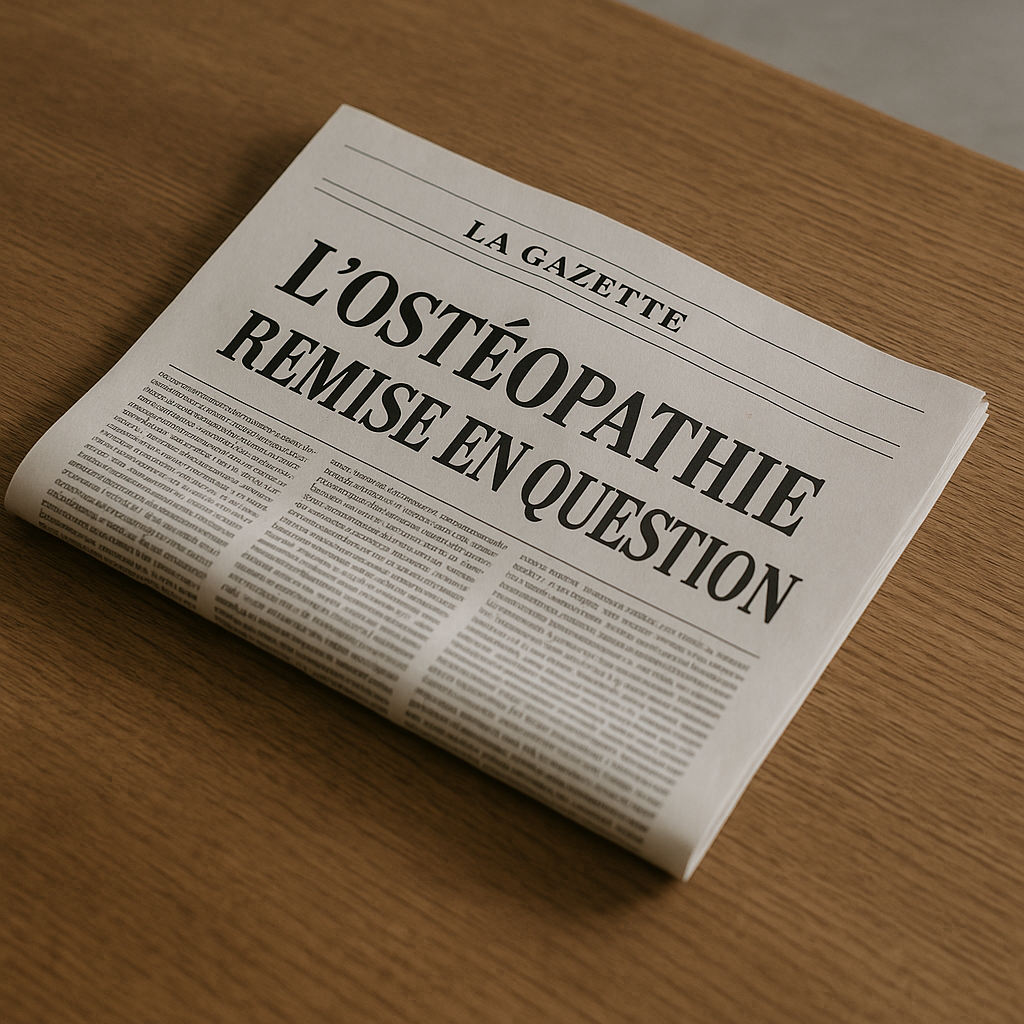
Une convergence de courants, plus qu’un complot
Il n’y a pas de “main invisible” derrière le phénomène. Pas de manipulation orchestrée. Mais il existe bel et bien des groupes organisés, influents, et idéologiquement alignés, qui contribuent à alimenter une défiance constante à l’égard de l’ostéopathie.
On trouve d’abord des collectifs rationalistes ou zététiciens, pour qui tout ce qui n’est pas validé par des essais cliniques contrôlés est considéré comme suspect.
Certains, comme Fakemed, l’AFIS (Association Française pour l’Information Scientifique), ou des figures issues de la zététique universitaire (notamment autour de l’Université Grenoble-Alpes), mènent une veille active sur les pratiques qu’ils jugent “non scientifiques”.
Leur action peut parfois être salutaire, en pointant certaines dérives réelles. Mais leur regard est rarement neutre.
L’ostéopathie y est souvent traitée comme un symbole : celui d’une médecine perçue comme irrationnelle, floue, ou trop populaire pour être fiable.
Ces discours circulent largement, relayés par certains journalistes spécialisés, des tribunes médicales, ou encore des interventions sur les réseaux sociaux et les plateaux télé.
Le message, lui, est clair : à leurs yeux, ce qui échappe à leur méthodologie est disqualifié
Viennent ensuite certains représentants du monde médical académique. Pour eux, l’ostéopathie reste une profession périphérique, non médicalisée, difficile à encadrer.
Cette perception est régulièrement relayée par des organismes comme l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ou encore par des syndicats médicaux.
En 2025, la Société Française de Pédiatrie (SFP), en collaboration avec le Syndicat de Médecine Manuelle Ostéopathie de France (SMMOF), a émis un communiqué appelant à contre-indiquer la pratique de l’ostéopathie chez les nouveau-nés et les nourrissons. Ce communiqué souligne l’absence de preuves scientifiques solides concernant l’efficacité et la sécurité de ces pratiques chez les tout-petits, et met en garde contre des manipulations jugées au mieux inutiles, au pire risquées.
À cela s’ajoutent des enjeux de territoire professionnel, voire de concurrence.
Le discours dominant, souvent exprimé au nom de la prudence, glisse parfois vers une forme de rejet systématisée.
Enfin, certains journalistes spécialisés s’appuient sur ces sources pour produire des contenus alarmants.
Non par malveillance, mais par automatisme, facilité, ou habitude.
Les récits critiques sont souvent fournis “clés en main” par les groupes mentionnés. Ils donnent de la matière pour diffuser leurs opinions.
Et ce biais s’étend au point que même les démarches de clarification ou d’encadrement sont interprétées comme des signaux de danger.
Un exemple récent : en 2025, le CFRO (Collège pour la Formation et la Recherche en Ostéopathie) a initié un travail remarquable autour de l’information sur les actes périnéaux, dans un souci de transparence et de protection des patients.
Mais l’article publié dans L’Express titrait aussitôt :
“Non, les ostéopathes ne sont pas autorisés à faire des touchers pelviens en France.”
→ Voir l’article
L’article mentionne d’emblée « de nombreux ostéopathes » qui réaliseraient ce type de techniques comme si elles étaient répandues, ne s’appuyant sur aucun chiffre sérieux.
Le propos est juste sur le fond.
Mais le cadrage renforce l’idée d’un danger latent, comme si l’existence même de cette question confirmait une dérive généralisée.
Ce genre de traitement alimente un climat de soupçon permanent, où toute parole devient suspecte, y compris lorsqu’elle va dans le sens de la protection ou de l’éthique.
Un terrain médiatique particulièrement favorable
L’ostéopathie cristallise un paradoxe : elle est à la fois très populaire et mal connue. Elle touche au corps, au toucher, à la douleur. Elle échappe aux classifications simples. Elle peut soulager là où d’autres échouent, mais elle ne peut pas toujours l’expliquer dans les termes attendus.

Pour les médias, c’est un sujet idéal :
- Il mêle santé, émotions, croyances et peurs.
- Il permet de rejouer un vieux clivage : science contre pseudo-science.
- Et surtout, il fait face à une profession dont la défense est désorganisée.
L’ostéopathie ne dispose pas d’un ordre professionnel, ni d’un porte-parole reconnu dans les grands médias.
Ses praticiens ne parlent pas d’une seule voix : les discours sont éclatés, les formations sont hétérogènes, les écoles nombreuses et parfois concurrentes.
La recherche reste dispersée, sans institution centrale pour la porter collectivement.
En face, les critiques sont coordonnées, réactives, médiatiquement entraînées.
Le résultat, c’est un déséquilibre dans le traitement de l’information. Des faits isolés sont généralisés. Des doutes deviennent des conclusions. Des débats internes sont présentés comme des preuves d’incohérence. Tout cela, sans que l’on prenne réellement le temps de comprendre ce que propose cette discipline dans sa diversité.
Une critique, oui. Un procès, non.
L’ostéopathie, comme toute profession de santé, a ses limites, ses tensions, ses excès. Il est nécessaire d’en parler. Il est même sain de débattre de ses fondements, de sa formation, de sa place dans le système de soin.
Mais le traitement médiatique actuel ne relève plus du débat. Il relève du procès permanent, souvent à charge, rarement nuancé.

Or une discipline ne se réduit pas à ses excès. Elle se juge aussi à sa pratique quotidienne, à son rapport au patient, à sa capacité à évoluer. Ces dimensions là sont trop peu montrées.
Rétablir une parole équilibrée
Il ne s’agit pas ici de demander un passe-droit. Ni de nier les critiques. Il s’agit simplement de rappeler qu’aucune profession ne peut évoluer sous la pression du soupçon permanent. Que le soin, quel qu’il soit, mérite d’être regardé autrement qu’à travers le prisme de la peur ou du mépris.
Et que si l’ostéopathie dérange, ce n’est peut-être pas uniquement parce qu’elle serait floue, mais aussi parce qu’elle interroge une manière de penser le soin que certains voudraient figer.
Je pense qu’il est grand temps de cesser de nous excuser d’exister.
Ostéopathes, nous savons ce que nous faisons.
Nous n’avons pas la prétention de tout guérir, mais nous accompagnons, nous soulageons, nous écoutons.
Chaque jour, dans nos cabinets, nous recevons des patients en errance, en attente d’écoute ou en manque de réponses.
L’ostéopathe n’a pas pour vocation à combler un manque dans l’offre médicale.
Il ne remplace pas un médecin, un kiné ou un psychologue.
Mais il peut apporter un soutien. Un autre regard. Une autre approche.
Je ne dis pas que tout est parfait. Je dis simplement qu’il y a là une façon de soigner, différente, parfois dérangeante, mais légitime.
La critique a sa place. Mais ce qu’on appelle “bashing” n’est plus une critique : c’est une disqualification.
Et dans ce climat, je crois qu’on a le droit de poser une parole juste, sans s’excuser.
Certes, il y a encore beaucoup à comprendre. Il y a aussi, déjà, beaucoup de choses à entendre, à voir, à reconnaître.
À propos de l’auteur
Olivier NTSIBA est ostéopathe D.O., formateur, et président de l’ANOEH (Association Nationale des Ostéopathes Engagés auprès des personnes en situation de Handicap). Il dirige également Form’Ost, un organisme de formation indépendant engagé sur les enjeux du soin, du handicap et de la relation thérapeutique.
Il exerce à Lyon 8, Dardilly, Vénissieux et Bourgoin-Jallieu.




